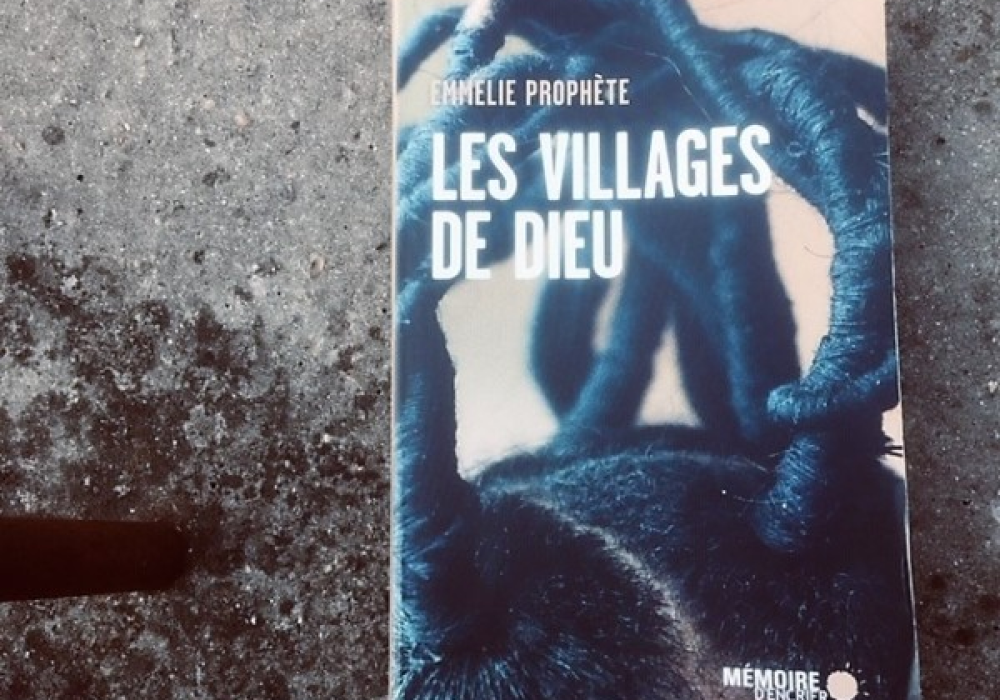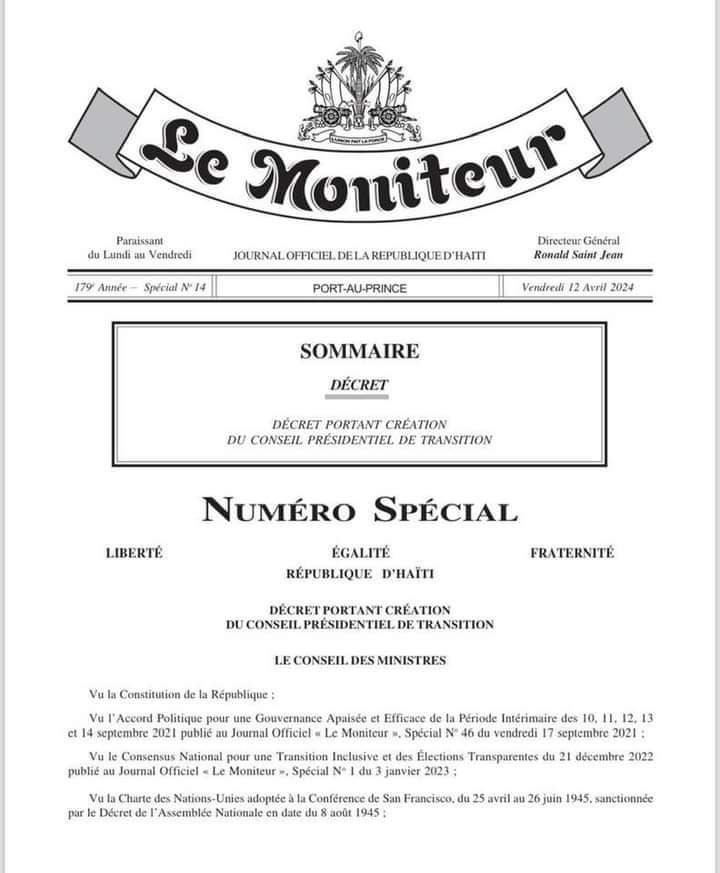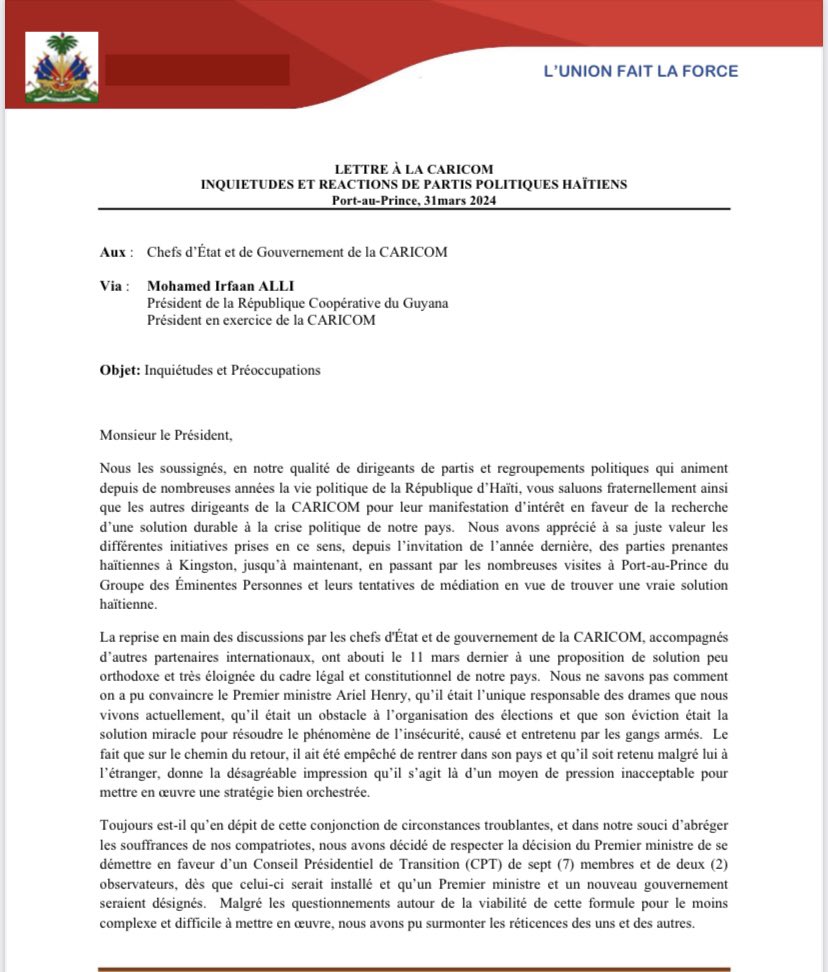Emmelie Prophète s’attaque avec maestria et sans concession, dans son dernier roman, aux gangs qui gangrènent Haïti pour le profit de quelques-uns, cachés derrière leurs paravents tape-à-l’œil, tandis que la population lutte pour se tenir droite et sauvegarder espoirs, rêves et sensibilité commune et individuelle
Derrière le pseudo facebookien Cécé la flamme, derrière les punchlines agressives contre tout ce qui ressemble à un officiel et les photos hardcores des macchabées jonchant les rues, une jeune fille au physique quelconque prénommée Célia, habitante de la cité de la Puissance Divine.
Les gourdes pour obtenir le smartphone qu’elle ne quitte désormais plus, elle les a arrachées lors d’une première passe avec Carlos, son unique client devenu amoureux transi, mais qui est bien loin de la bouleverser. C’est que, dans les cités qui portent des noms pompeux teintés de religiosité (comme pour mieux camoufler une réalité désespérément terre-à-terre : survie, recherche des biens de première nécessité, quête de l’eau, évitement du plomb volant des brigands et des matraques policières), on ne s’attache pas au premier regard, on ne livre ni son âme ni sa souveraineté au premier venu.
Malheur aux ingénues, victimes désignées ! Rapports rêches et détachement quotidien sont de mise pour qui espère tenir debout et même — folie suprême — se tirer du guêpier dans lequel le destin a eu la méchante idée de vous balancer. Qui plus est lorsque la vie a poussé l’audace jusqu’à vous créer femme sur ce bout de bitume mal famé.
Le lecteur l’aura compris : la poétesse et romancière Emmelie Prophète ne prend pas de gants dans ces « Villages de Dieu » déjà numéro un des ventes au Québec (et tout juste sorti en Europe). Elle déroule à travers des chapitres courts, tranchants comme des rasoirs, l’histoire de cette jeune femme guerrière élevée par sa grand-mère dans un bidonville portant nom biblique, de père inconnu et de mère toxicomane déchiquetée par la cité. Si le style et le ton célébrés par Dany Laferrière sont bien plus travaillés que ceux de Cécé la Flamme, vedette locale du web, c’est bien la même rage contre l’injustice, contre le statu quo et l’apathie du monde qui s’expriment.
« Le corps avait été décapité. Il gisait dans le corridor, entre chez Edner et chez Joe. Personne ne manquait pourtant à l’appel. Ses poignets étaient ligotés par-derrière, le sang avait rendu brune sa chemise rouge. Il avait dégouliné jusqu’à la ceinture de son jean bleu clair, et de larges taches rouges parsemaient ses bottes, des chaussures de marche aux semelles dentelées jaune clair. Il était propre. La tête qui manquait devait être jeune. Bien portante. Les épaules étaient larges et le corps musclé. Un filet de sang sortait de ce qui restait de cou, un corps chagrin qui pleurait sa tête. » Clic, clac.
Emmelie Prophète ne place pas un ouvrage de Jacques Stephen Alexis ou de René Depestre entre les mains de sa narratrice, du jeune Pierrot obligé de prêter allégeance au nouveau chef du quartier ni entre celles du psychopathe Cannibale 2.0 qui n’aime rien tant que séparer ses proies entre deux bières. Nul besoin d’enrichir artificiellement la vie intérieure de ses personnages en leur prêtant une gourmandise pour les Lettres qu’ils n’ont pas le temps d’avoir : la romancière colle plutôt à leurs pensées et gestes quotidiens, silences et sursauts dans ce cadre sans pitié pour révéler leur complexité, leur humanité malmenée, accentuant l’effet souricière, trappe fatale pour ces gens mal nés.
Tout moun se moun, men tout moun pa menm.
« Il y a plein de pays à l’intérieur de ce pays. »
Les lecteurs non haïtiens connaissent la richesse culturelle unique, incomparable, sans cesse renouvelée de l’île. Tout comme l’histoire glorieuse de la Révolution. Nul besoin d’habiller le vrai par des références semblant posées là pour faire contrepoids, « oui, mais, il n’y a pas que la violence et la misère. » Les lecteurs étrangers le savent, cela, mais bien souvent, enfants gâtés qui s’ignorent, ils ne réalisent pas le degré d’abandon auquel sont confrontés les déshérités insulaires, ne parvenant pas vraiment à visualiser, à intégrer la notion d’État défaillant ni celle de gangs omniprésents. Sur ce point, par son absence d’artifices et par sa sincérité blessée, « Les Villages de Dieu » est d’une efficacité, d’une férocité incroyables. Nécessaires pour, peut-être, provoquer un électrochoc dans les consciences occidentales, gangrenées par le poison lent du relativisme et du nombrilisme (mollesse des réactions concrètes au séisme du 14 août).
Le destin de Célia basculera lorsque Joël, l’un des chefs forcément éphémères du quartier (les balles de l’ambitieux suivant attendent l’heure propice pour mettre fin au règne en cours, ouvrir la voie à un nouveau qui connaîtra la même fin, cercle infernal, otages similaires), la chargera de promouvoir sur le réseau social ses bienfaits envers les habitants de la zone, sa cruauté envers ses ennemis. Comment refuser, à moins de vouloir finir en position fœtale, gorge béante, près d’une poubelle ? Les compromissions de Célia avec le Crime sont bien peu comparées à celles de ceux qui déboulent parfois sirènes hurlantes, en 4×4, demander audience au chef du gang, cet idiot utile des pouvoirs corrompus, des écuries intouchables, cet exécutant aux yeux inquiets des basses-œuvres des puissants.
« — Mesdames, vous êtes les poteaux-mitan de notre cité, le chef Joël fait beaucoup d’efforts pour faire baisser les prix afin que vous puissiez nourrir sans difficulté vos familles, il veut compter sur vous pour que nous vivions en paix ; il a besoin de votre support pour accomplir sa tâche, vous devez parler à vos maris afin qu’ils lui soient dévoués. Il est là pour nous protéger tous.
Il commençait à faire chaud. Les bêtises débitées par la belle Patience n’arrangeaient rien. Soline avait des plis au front. Les autres dames la regardaient avec étonnement, sans rien dire. »
Entourée de bandits en armes, Patience, la compagne du chef de jouer (mal) les dames patronnesses, distribuant maladroitement sacs de riz et « conseils » appuyés aux femmes du quartier. Des vivres détournés par le gang, comme risquent de l’être aujourd’hui ceux envoyés vers le sud de l’île. La femme-trophée du maître de la zone semble mimer certaines Premières dames du passé, pires exemples mafieux du clientélisme, de l’infantilisation. Les seuls modèles, sans doute, qui l’ont hélas impressionnée. Peut-être, petite, a-t-elle assisté à l’obscène lancer de billets depuis les fenêtres d’une limousine par une Michèle Bennett Duvalier hilare… Le grotesque de la scène atterre le parterre de femmes « convoquées». Que peuvent-elles faire, sinon remercier ?
L’oncle Frédo, revenu brisé des USA qui l’ont refoulé, ont détruit ses maigres espoirs d’une existence convenable, Yvrose la veuve qui relie encore physiquement Célia au fantôme d’une Grand Ma désormais disparue, la seule aimée dans ce monde en décomposition (“dans la confusion des vies et des messages, de trébuchement en trébuchement, Yvrose faisait partie d’une histoire sans retentissement, image qui tourne sans pouvoir s’imprimer dans l’esprit, une femme passée au travers de la vie, qui s’en allait sans comprendre, sans rien demander non plus”), Fanfan Le Sauvage, Franzy Petit Poignet (“affrontement final. Un seul chef devait régner à Bethléem”), Fany la belle, poursuivie par un pasteur libidineux : la galerie de personnages tous plus touchants les uns que les autres, tous survivants et otages d’un système aux allures faussement anarchiques, leurs rapports compliqués faits de reconnaissance et de méfiance (les chefs et membres des gangs ayant côtoyé ou grandi sous les yeux des autres) donnent au récit la force du reportage tandis que la poésie et la rage de l’écrivaine haïtienne y apportent un souffle qui bouleverse, renverse, dessille.
Célia, bientôt influenceuse reconnue, contactée par une marque de cosmétiques pour promouvoir des produits blanchisseurs de peau sur ses pages (habile moyen pour l’auteure d’évoquer les connotations sociales liées à l’épiderme en Haïti, triste héritage colonial plus ou moins inconscient), regarde les chefs des gangs tomber, des nouveaux les remplacer. Les gourdes s’accumulent un peu, elle ne sait trop qu’en faire. La Puissance de Dieu et ses habitants chevillés au corps. Le quartier change sans changer, tout a été pensé pour qu’il en soit et reste ainsi.
À travers cet incroyable portrait d’une jeune femme combattante qui ne peut se payer le luxe de s’attacher, de se livrer, ni même de rêver, à travers cet hallucinant tableau d’un quartier tenu par les gangs, d’un pays lâché par ses gouvernants et par la communauté internationale, Emmelie Prophète donne naissance à un roman à la cruauté, mais aussi à l’humanité hallucinante qui marque, qui secoue les esprits. Qui restera. Et qui — peut-on l’espérer ? – réveillera les consciences avachies, démissionnaires, indifférentes. Une claque radicale. Indispensable. Sur la fatigue qui gagne un peuple par trop abusé, floué. Sur l’amour d’une écrivaine pour ses compatriotes, pour sa nation, qui ne peut se résoudre à l’impuissance.
“Les Villages de Dieu”, Emmelie Prophète, ed. Mémoire d’Encrier